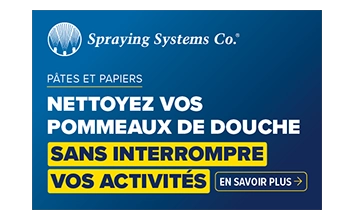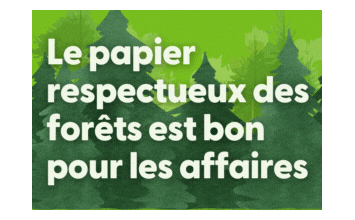Pourquoi le Traité mondial sur les plastiques est important pour l'industrie canadienne de l'emballage
Après près de trois ans de négociations, le sixième cycle de négociations sur un traité mondial sur les plastiques s'est achevé le 15 août en Suisse. Des représentants de 183 pays, dont le Canada, et plus de 400 organisations se sont réunis pour travailler à un accord juridiquement contraignant visant à lutter contre la pollution plastique tout au long de son cycle de vie, de la conception à l'élimination, en passant par la production.
Bien qu’aucun traité final n’ait été conclu à ce stade, les discussions qui ont eu lieu – et les appels renouvelés à l’action à la suite du dernier cycle de négociations – continuent de signaler un engagement fort à lutter contre la pollution plastique, tant à l’échelle internationale qu’ici au Canada.
Qu'est-ce que le Comité intergouvernemental de négociation (CIN) ?
Ces discussions se déroulent sous la direction du Comité intergouvernemental de négociation (CIN), un organe temporaire des Nations Unies (ONU) créé en mars 2022. Son mandat est d’élaborer un instrument juridiquement contraignant au niveau international pour traiter des plastiques tout au long de leur cycle de vie : de la conception et de la production (en amont) à l’utilisation, au recyclage et à l’élimination (en aval).
L'INC était initialement chargé de conclure les négociations d'ici fin 2024. Cependant, le cinquième cycle de négociations, connu sous le nom d' INC 5, organisé en décembre 2024 à Busan, en Corée du Sud, s'est terminé sans consensus. En conséquence, l'ONU a programmé une session supplémentaire, l'INC 5.2, en août 2025 à Genève, en Suisse. Après dix jours de discussions, les représentants n'ont pas pu parvenir à un accord, reflétant les priorités divergentes des pays qui prônent une limitation de la production de plastique et ceux qui privilégient une approche plus ciblée sur la gestion et le recyclage des déchets.
En l'absence d'accord lors de la réunion 5.2 du CNI, la question de la tenue d'un nouveau cycle de négociations (par exemple, une réunion 5.3 du CNI) demeure. Quoi qu'il en soit, la lutte contre les déchets plastiques et la pollution continue de progresser, compte tenu des liens croissants avec leur impact sur la santé humaine et l'environnement.

Où se situe le Canada?
En tant que membre fondateur de la Coalition de haute ambition pour mettre fin à la pollution plastique – un groupe de pays ambitieux engagés à mettre fin à la pollution plastique d’ici 2040 – le Canada s’est positionné comme un partisan d’un traité mondial complet sur la pollution plastique.
Dans la déclaration du gouvernement du Canada sur la conclusion de l'INC-5.2, le ministre de l'Environnement, Dabrusin, a déclaré :
« S'attaquer à ce problème est complexe et nécessite une approche globale à l'échelle du système pour conduire le changement durable nécessaire pour mettre fin à la pollution plastique… Au niveau national, nous mettons en œuvre un plan global pour réduire les déchets plastiques et la pollution, promouvoir une économie circulaire pour les plastiques et favoriser la science, l'innovation et la transparence. »
La déclaration réitère l'engagement du Canada à conclure un traité mondial ambitieux et efficace qui aborde l'ensemble du cycle de vie des plastiques. Conjuguée à son Programme zéro déchet de plastique , qui comprend des politiques visant à réduire l'utilisation de plastiques à usage unique, cette déclaration souligne l'objectif du Canada d'adopter un cadre plus cohérent et harmonisé pour la réduction et la gestion des déchets plastiques.
Le rôle du Canada dans les négociations sur le traité sur les plastiques s’appuie sur une longue histoire d’accords environnementaux multilatéraux, qui démontrent comment la coopération mondiale peut relever des défis complexes.
Comprendre les traités mondiaux
Des accords mondiaux comme celui-ci ne sont pas faciles à conclure. Ils nécessitent des années de débats et de multiples cycles de négociations avant de parvenir à un consensus.
Prenons l' exemple du Protocole de Montréal . Après la Convention de Vienne de 1985 sur la protection de la couche d'ozone, les gouvernements sont parvenus à un accord sur le Protocole de Montréal en deux ans, après deux cycles de négociations. Ce traité est devenu l'un des accords environnementaux les plus réussis de l'histoire : il a été ratifié par 197 pays, a éliminé 98 % des substances appauvrissant la couche d'ozone et a permis la reconstitution progressive de la couche d'ozone.
Mais le traité mondial sur les plastiques est différent. Il a déjà nécessité plus de trois ans et six cycles de négociations sans parvenir à un consensus. Contrairement aux substances appauvrissant la couche d'ozone, les plastiques pourraient être plus complexes : il existe des centaines de types de polymères, et les matières plastiques sont profondément ancrées dans les économies modernes, les chaînes d'approvisionnement et la vie quotidienne. Si l'on ajoute à cela l'essor de la culture de la commodité pour les consommateurs – achats en ligne, plats à emporter, livraison de repas, kits repas, produits prédécoupés –, les plastiques sont devenus omniprésents dans la production, le transport et la consommation des biens. Ces réalités rendent l'élaboration d'un traité mondial plus complexe.
Les progrès sont encore compliqués par la résistance de l'industrie, notamment des pays producteurs de pétrole et de plastique, qui continuent de plaider en faveur d'un traité plus restreint, axé sur la gestion des déchets plutôt que sur les limites de production. Ce clivage explique en partie la lenteur des négociations.
L'histoire montre que les accords mondiaux peuvent être des outils puissants pour l'action environnementale, mais le paysage actuel est plus fragmenté et complexe que par le passé. Si un traité contraignant sur les plastiques pourrait apporter clarté, harmonisation, solutions à grande échelle et éviter une approche fragmentée, les progrès dépendront en fin de compte d'une action coordonnée entre les gouvernements, l'industrie et la société.

Conséquences pour le secteur de l'emballage au Canada
Que le traité mondial sur les plastiques aboutisse ou non à un moment donné, les négociations auront des implications importantes pour le secteur de l’emballage au Canada.
Pour les emballages en papier, et pour tous les secteurs de l’emballage, la manière dont un traité ultime définit les responsabilités en matière de gestion des matériaux, et s’il se concentre sur les limites de production, la gestion des déchets, ou les deux, pourrait avoir des implications sur les systèmes de recyclage et les cadres politiques mondiaux.
Alors que les gouvernements et l’industrie continuent de chercher à s’éloigner des plastiques, les emballages en papier peuvent être considérés comme une alternative compte tenu de leur grande recyclabilité, de l’utilisation importante de contenu recyclé comme matière première et de leur alignement sur les modèles d’économie circulaire.
Cela dit, les emballages en général continueront probablement à faire l’objet d’un examen minutieux en raison des impacts potentiels sur l’environnement et la santé associés à leur production, leur utilisation et leur gestion en fin de vie.
Le débat actuel autour du traité sur les plastiques illustre une réalité plus vaste : l'emballage n'est pas seulement une question de matériaux, c'est un défi systémique. Pour les emballages papier, cela implique de rester proactif, transparent et engagé en faveur de solutions circulaires, quelle que soit l'évolution des négociations internationales.
Conclusion
Bien que le sixième cycle de négociations n'ait pas abouti à un traité sur les plastiques, le travail n'est pas terminé. Le Canada a réitéré son engagement en faveur d'un accord mondial, et qu'un traité soit finalement conclu ou non, la réduction et la gestion des plastiques demeurent une priorité mondiale urgente.
L'histoire nous montre que des accords internationaux comme le Protocole de Montréal peuvent apporter la structure et la clarté nécessaires pour impulser un véritable changement. Mais cela prend aussi du temps, et le contexte actuel est différent. Contrairement au défi de la couche d'ozone des années 1980, les emballages et les plastiques sont désormais profondément ancrés dans la vie quotidienne, du commerce électronique à la vente à emporter, ce qui complexifie les solutions évolutives.
Alors que nous attendons les prochaines étapes, il est clair que l’absence d’un accord contraignant à l’heure actuelle n’est pas une excuse à l’inaction ; le leadership de l’industrie, l’innovation, l’action des consommateurs et les politiques responsables doivent continuer à favoriser des améliorations tangibles dans la durabilité des emballages.
 Rachel Kagan
Rachel Kagan
Directrice exécutive
Conseil environnemental des emballages papier et carton (PPEC)